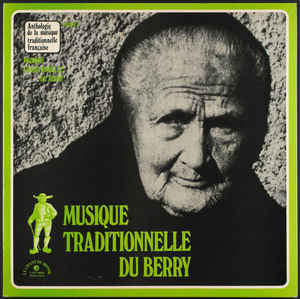Contribution FAMDT Modal 2025
Michel Lebreton
Introduction
Ce texte s’appuie sur des constats concernant l’évolution des pratiques musicales ainsi que des aspirations afférentes portées par les citoyens d’aujourd’hui. Il est très (trop ?) synthétique et mériterait de nombreux développements informés. Son objectif est de partir de ces deux constats pour poser les choix de formation musicale qui en découlent. Et de constater que les pratiques des musiques traditionnelles sont en concordance avec ces objectifs. Et qu’elles participent, déjà en de nombreux endroits, à cet élan émancipateur en phase avec l’évolution de la société : jouer pour apprendre, expérimenter pour s’exprimer, coconstruire pour créer, inventer ensemble.
1- Ce qui est « musique » aujourd’hui
Depuis maintenant 70 ans :
- La musique se décline en des genres de plus en plus multiples ;
- Les moyens de la produire ont suivi le même chemin par des innovations en lutherie, l’électrification et la numérisation ;
- Les moyens de la diffuser touchent désormais la planète par le streaming, les vidéos… et plus localement de nombreuses salles et festivals… ;
- Les pratiques conjuguent interprétation, création, improvisation, inventions de toutes sortes ;
- Le groupe est la forme la plus répandue dans ce que l’on nomme en France « Musiques Actuelles ». Les musiciens « Classique à Contemporain » sont désormais en recherche de ce genre de pratique : vivre, partager des expériences, coconstruire un univers musical, se réaliser par la présence et la force des autres.
Les désirs d’apprentissages se nourrissent de cette mosaïque, chacun y faisant « son marché » au gré de son histoire, ses goûts, son capital culturel, ses engagements… mais aussi de ses moyens ou de ceux de son lieu de formation.
Nombreux sont celles et ceux qui cherchent alors un lieu d’apprentissage qui corresponde peu ou prou aux projections, aux représentations qu’elles – ils ont élaborées. Ou, à minima, au choc émotionnel vécu lors de la découverte sonore d’un instrument.
2- Quel lieu pour quelles pratiques ?
Si nous tentons une description d’un lieu de formation lambda répondant à ces réalités contemporaines, il devrait :
- Être une Maison des Musiques offrant un choix de disciplines variées liées pour partie au territoire du lieu, aux populations du lieu ;
- Encourageant la pratique de démarches collaboratives entre :
- Enseignants et apprenants ;
- Enseignants ;
- Apprenants ;
- Lieu de formation et acteurs culturels du territoire et au-delà.
- Ainsi que le développement de projets mettant chacun, y compris et surtout les apprenants, en conscience de « faire le monde » : découvrir l’autre et se découvrir dans un même élan ;
- Et proposer une variété d’outils permettant de pratiquer en se nourrissant aux sources : enregistrements audio, vidéo ; partitions papier ; outils numériques ; rencontres avec des praticiens ; collectages…
3- Formation à des pratiques émancipatrices
Ces objectifs nécessitent des démarches adaptées dont voici les principales :
- Développer le goût du son par une démarche d’exploration, de tâtonnement expérimental s’appuyant d’abord sur l’écoute par le corps, l’auralité ;
- Encourager les expérimentations collectives faisant appel à l’imagination mise au service d’un travail en groupe ;
- Accompagner les apprenants dans la recherche d’une organisation collective nourrie des points précédents et suivants ;
- Associer apprentissage instrumental, chant/voix et danse/mouvement afin de développer conjointement technique, ressenti et expression ;
- Y associer de même la découverte des sources par leurs exploitations et leurs contextualisations au sein des projets ;
- S’appuyer dès la 1ere année sur des jeux d’improvisation afin que les apprenants se sentent autorisés à explorer, écouter, proposer des idées, essayer librement des sons, faire des suggestions musicales, composer ou encore échanger avec les autres ;
- Travailler donc dans le cadre d’une pédagogie de groupe ;
- Construire son enseignement dans une optique démocratique et émancipatrice.
Notons que le cours individuel trouve toujours sa place pour peu que ses objectifs soient complémentaires avec les points ci-dessus. N’oublions pas que le face à face professeur élève est fondamentalement inégal, le premier ayant une emprise inévitable sur le second, même si « le prof est sympa ! ». Trop axer la formation sur le cours individuel ou sur un orchestre aux ordres rentre donc en contradiction avec les objectifs ci-dessus.
4- Et la pratique des musiques de tradition orale ?
Le tableau brossé ci-dessus est à la fois cohérent avec :
- L’évolution de la société vers davantage d’émancipation ;
- La nécessité de mettre l’enseignement en phase avec ces évolutions ;
- La majorité des pratiques musicales contemporaines ;
- La richesse des pratiques des musiques de traditions orales collectées au fil du temps.
On peut en déduire que la pratique contemporaine des musiques de tradition orale, telle que transparaissant dans le projet de transmission ci-dessus, peut être en phase avec les aspirations de notre époque. Et en phase avec le projet global de formation tel qu’il est esquissé dans ce texte. Projet auquel ces pratiques musicales peuvent donc apporter leur pierre. Encore faut-il que les acteurs en expriment la volonté et puissent la mette en œuvre.
5- Pratiques d’abord
J’insiste sur l’angle d’approche par les pratiques parce qu’il permet de faire se rencontrer des musiciens de tous bords dans un objectif commun. Ils viennent évidemment avec leurs disciplines, leurs répertoires, leurs cultures, leurs amours musicaux mais ils les mettent en jeu dans un projet qui les englobe tous. Dès lors, les prééminences s’estompent, les jugements de valeur se relativisent, l’écoute émerge, attention et respect s’ensuivent, le plaisir peut se faire jour. Les pratiques de chacun s’éclairent des pratiques des autres.
6- Et la suite ?
Ce tableau vite brossé est une projection sur des développements qui participent de l’évolution inévitable des écoles de musique (institutionnelles comme associatives) et conservatoires. En effet, si les inscriptions restent importantes dans ces structures, les désaffections dans les quatre premières années ne le sont pas moins. En tout cas dans les lieux qui restent attachés, in fine, à former de potentiels professionnels ou des amateurs mais selon les mêmes catégories. A savoir, former un technicien du meilleur niveau apte à se produire en public. Or, si la formation technique et la capacité de jouer sur scène sont des objectifs qui ont leur place, nous avons vu ci-dessus que ces seules pratiques font l’impasse sur une visée émancipatrice de la formation : expérimenter, s’exprimer, échanger, inventer, seul et en groupe (qui n’est pas un ensemble !), se projeter dans des projets ouverts entre partenaires et sur le territoire, laisser davantage de place aux catégories populaires qui se reconnaissent moins que d’autres dans l’image traditionnelle du « Conservatoire », « Temple de la musique classique ».
Je terminerai sur ce texte de présentation des Journées d’étude 2025 de Conservatoires de France[1]
Aller vers, accueillir : la diversité au cœur de l’établissement d’enseignement artistique
« Le conservatoire, ce n’est pas pour moi ! »
Partons de ce constat simple : les politiques publiques de la culture, pourtant fondées sur des principes d’éducation et d’émancipation, produisent des effets de domination et d’exclusion*
Cependant, partout en France, des acteurs culturels, des artistes et des équipes pédagogiques s’engagent pour conjuguer de manière concrète les diversités et faire place au plurilinguisme culturel. Les expériences de ces hospitalités ne manquent pas !
A travers l’analyse de leur processus de fabrication, leur fondement théorique, les questions qu’elles soulèvent, les journées d’étude 2025 de Conservatoires de France proposent de mettre en débat les conditions de ce double mouvement : Aller vers, accueillir … comme autant de formes de connaissance et de reconnaissance de l’altérité et du métissage au sein des établissements d’enseignement artistique.
*Fabrice Raffin, maître de conférences en sociologie, « Les politiques culturelles, déconnectées, excluent trop souvent les catégories populaires » observatoire des inégalités.
Le débat est ouvert…
Michel Lebreton
Ex coordinateur du département de musiques traditionnelles du CRD de Calais
http://leschantsdecornemuse.fr/enseignement.html : La transmission et l’enseignement des musiques de tradition orale
[1] https://conservatoires-de-france.com/journees-detudes-2025-aller-vers-accueillir-la-diversite-au-coeur-de-letablissement-denseignement-artistique/